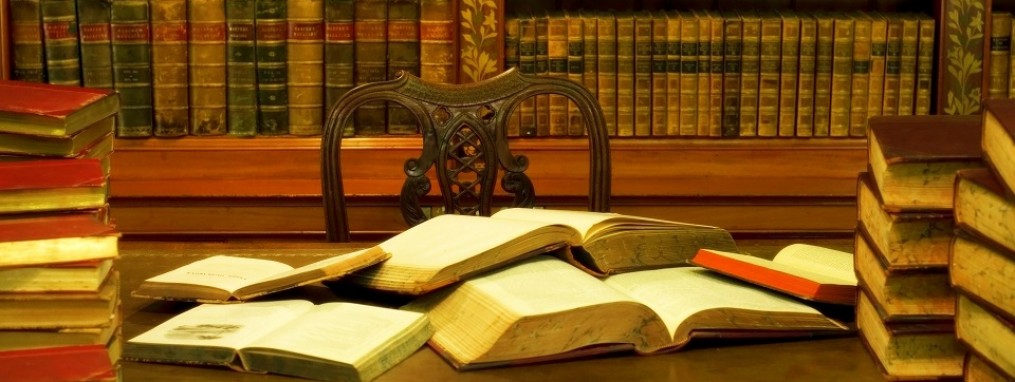La Vie d’Arséniev, Ivan Bounine, Le Livre de Poche, 2008 (Trad. Claire Hauchard ; première éd. française 1999 ; première éd. originale définitive 1952 ; Titre original : Жизнь Арсеньева)
Quatorzième note de la série « Prix Nobel de Littérature » (ont déjà été abordés par le passé : Saul Bellow (Nobel 1976), Heinrich Böll (1972), Bjørnstierne Bjørnsøn (1903), William Faulkner (1949), Sinclair Lewis (1930), V.S.Naipaul (2001), Kenzabûro Ôe (1994), Luigi Pirandello (1934), Georges Séféris (1963), John Steinbeck (1962), Theo Walcott (1992), Patrick White (1973) et William Butler Yeats (1923)). Ivan Bounine a reçu cette récompense en 1933.
Si l’enfance représente pour tout homme un « pays perdu », l’enfance de l’exilé est, pour lui, un « pays doublement perdu ». Le passé est par principe inaccessible ; toutefois, le lieu, les objets, les odeurs, les saveurs permettent de se le rappeler, de faire remonter, par les sens, un ensemble irrémédiablement perdu et pourtant préservé, plus ou moins inactif, au fond de la mémoire. Voir à nouveau, entendre à nouveau, toucher à nouveau, sentir à nouveau, goûter à nouveau ; rejaillissent soudain, venus des tréfonds de l’âme, des images et des sentiments lointains, des émotions et des plaisirs qu’on pensait oubliés. Un coffre à jouets, une armoire familiale, une vieille maison ramènent à la surface de l’esprit ces détails évanescents, et donnent, par l’effet de distance qu’ils suggèrent, la claire et mélancolique conscience du temps qui passe, pour toujours. Tempus fugit. Pour l’exilé, arraché spatialement et temporellement au pays de son enfance, se remémorer est plus douloureux : les sens, dans un environnement lointain, différent, se laissent moins aisément solliciter ; l’effort conscient de la mémoire renforce l’écart entre le présent et un passé doublement perdu ; s’animent peu à peu les fantômes de l’enfance et de la jeunesse, la famille, trépassée depuis, les amis, éloignés, les lieux, hors de portée, les situations, évanouies. Le souvenir ne ramène pas seulement à la surface de la conscience un état perdu, mais une société, une civilisation, un monde. La poésie naît de cette émotion, de cette sensibilité extrême à ce qui n’est plus, au passé, à la mort ; le douloureux bonheur de faire revivre. Dans La Vie d’Arséniev, roman autobiographique, Ivan Bounine, retrouve, par l’écriture, une jeunesse perdue, vécue dans un lieu perdu, à une époque perdue dans un pays perdu. Tout souvenir d’enfance est élégiaque, et celui-ci l’est doublement, triplement, quadruplement. Car celui qui l’écrit ranime à distance cet univers disparu ; il vit à Grasse, au bord de la Méditerranée, comme d’autres exilés russes, partis en 1917 lorsque leur pays bascula dans une autre ère historique ; il ne rentrera pas, et le sait. Faire revivre la Russie profonde, par la plume, est un acte à la fois bienfaisant – s’opposer à l’oubli, au grand destructeur qu’est le temps – et mutilant – se rappeler que tout cela est mort, inaccessible, image condamnée à disparaître quand périront les derniers survivants de cette époque. Les êtres d’espérance, épris d’avenir et de lendemains ne seront pas touchés par ce tableau ; en revanche, ceux pour qui la beauté n’est jamais plus forte que perdue, remémorée, racontée, mythifiée, et le bonheur jamais plus touchant que disparu, ne peuvent qu’être émus par la fresque de Bounine.
Comme son titre invite à le penser, La Vie d’Arséniev n’est pas une autobiographie en bonne et due forme. Le narrateur se distingue de Bounine, par son nom comme par son existence. Les spécialistes ont noté, ici ou là, des écarts entre les vies de l’auteur et du narrateur ; ces différences portent tantôt sur des détails, tantôt sur des événements considérables. Pourtant, le matériau, bien que retouché, est trop fortement autobiographique pour ne pas être considéré comme une remémoration ; Bounine et Arséniev sont nés au même endroit, dans le même milieu et leurs parcours sont proches. L’auteur a romancé sa jeunesse, et, l’arrangeant par des effets d’art, lui a donné la puissance émotionnelle dont la vie brute est malgré tout dépourvue. Ce « mentir-vrai », comme aurait dit Aragon, transforme le témoignage en œuvre d’art, et le souvenir brut en élégie. Ici, il ranime la campagne des moujiks, là, les groupuscules intellectuels de la province des années 1890 ; la Russie de Pouchkine, de Gogol, de Tolstoï s’anime une dernière fois – elle est, au moment de l’écriture du texte, condamnée. Bounine ne peint pas seulement une société, mais une contrée, des paysages ; par ses notations lyriques, il s’offre un dernier voyage, transfiguré, dans l’épaisseur naturelle de la steppe, dans les chaleurs de ses brefs étés, dans les frimas de ses longs hivers. Bounine se détourne d’un progressisme obsédé par l’Homme, l’Histoire, la Société, abstractions à majuscules qui ne satisfont pas le poète ; de nombreuses et charmantes notations tentent de capturer, par un jeu d’images délicates, la nature, le paysage, les hommes. Ce n’est pas une littérature-outil, argument d’émancipation et de propagande ; Bounine recrée un passé disparu non pour le juger, mais pour le montrer, non pour le penser, mais pour le ressentir, une dernière fois. Toute la beauté du texte, irréductible à la glose la mieux inspirée – ce que n’est certes pas cette note – vient de sa justesse, de ce qu’elle touche exactement sa cible, sans emphase ni froideur ; l’auteur tisse un entrelacs très tenu de peines et de joies, au fil de ses souvenirs. S’il est évident qu’il déplore la disparition de la Russie d’hier, écrasée par la Russie des-lendemains-qui-chantent, et qu’il le fait d’une position sociale déterminée (la petite noblesse provinciale appauvrie), Bounine ne s’arrête pas là. Il n’anime pas par pure nostalgie une société disparue ; il lui insuffle la vie, par des détails, des instantanés, des émotions fugaces, un ensemble de choses vues qui donne sa cohérence au passé tout entier. Le père d’Arséniev, un des personnages les plus touchants du livre, est d’évidence le dernier rejeton dilapidateur d’une grandeur sur le point de s’éteindre ; sa maison est mal gérée, les terres mal exploitées. Les dettes s’accumulent. Son portrait n’est pas l’étude économico-politique d’une classe en voie d’extinction ; c’est celle d’un homme, avec ses imperfections, ses faiblesses, mais aussi ses grandeurs, d’âme notamment. Et lorsque, vers la fin du livre, Arséniev retourne voir son père, vieilli et appauvri, c’est pour retrouver l’homme déclinant mais heureux, cultivé, rieur, encore attentif à sa mise, affectueux. La mélancolie n’est ici jamais pitoyable ou obscure ; elle est légère, parfois souriante. Le narrateur présente ces figures pour leur donner un dernier souffle de vie, posthume, leur faire rejouer une dernière fois leur rôle dans une vieille pièce à la veille d’être oubliée, leur vie.
Bien que ce texte palpite souvent d’une force juvénile, avec ses espoirs, ses émerveillements, ses passions, la mort y occupe nécessairement une place importante. Trois personnages l’incarnent particulièrement (parmi d’autres) : le grand duc Nicolas, pour le versant collectif ; l’oncle, pour le versant familial ; l’épouse, pour le versant personnel. Le grand duc Nicolas Nicolaïevitch Romanov, cousin du Tsar, s’était établi en France après la révolution de 1917. À sa mort, en 1929, Arséniev/Bounine (la distinction s’estompe entre eux à cet instant) vint se recueillir sur sa dépouille, dans sa villa d’Antibes. Le narrateur/auteur avait déjà vu le prince une fois, de loin, en 1891, alors que le grand duc accompagnait le transfert de Crimée vers Saint-Petersbourg de la dépouille de son père (Nicolas Nicolaïevitch Romanov, fils de Nicolas Ier). La remémoration des instants d’un passé lointain suscite une digression soudaine hors de l’histoire d’une jeunesse. Est-ce Arséniev, est-ce Bounine, sont-ce les deux qui se recueillent devant le corps du Romanov ? Est-ce un simple hommage politico-narratif à un prince déchu ? Pas seulement. Le Romanov n’est pas un émigré de plus ; il occupait l’un des tout premiers rangs de l’émigration blanche ; sous la plume de Bounine, il incarne, par ses liens familiaux, par son importance politique et militaire, par son statut de survivant, également, la Russie, la Russie tsariste, la Russie ancienne, que le PCUS est alors en train de liquider. Cette prise de position littéraire, discrète – car Bounine ne fait pas de son roman un manifeste légitimiste – fut assez mal reçue par l’intelligentsia des années 50 (qui préférait ignorer des textes qu’elle estimait réactionnaires, jugeant sur la pureté supposée des intentions politiques, plus que sur la qualité réelle des réalisations littéraires). Arséniev se tenant devant le corps sans vie du grand duc, c’est un survivant devant le corps d’un autre survivant, pensant à la fin de son monde, et à sa propre fin ; leur distance sociale est en partie effacée par la macule de l’exil ; entre eux, se dessine une solidarité supérieure, puissante, celle des rejetés, qui doivent vivre hors de cette part inaliénable d’eux-mêmes qu’est leur patrie.
Une autre mort touche profondément Arséniev, celle de son oncle Pissarev, naguère si vivant, si puissant, et pourtant abattu en quelques jours par de subits malaises. Le jeune et sensible Arséniev, dont se dessine déjà, au loin, la vocation de poète, de nouvelliste, de romancier, rencontre pour la première fois l’inacceptable, la mort, la disparition, l’évanouissement pour toujours (ainsi cet instant où, devant le corps sans vie de l’oncle Pissarev, il songe à l’étendue insurmontable entre ce trépas et la résurrection des morts promise). Il prend conscience de la mortalité de ses proches comme de la sienne ; première rupture avec l’enfance, entendue comme un sentiment de l’éternité et de l’intangibilité ; première apparition du temps, du temps qui blesse, du temps qui tue. D’autres, après l’oncle, mourront. Aucune mort, pourtant, n’aura l’impact de celle-ci, la première, cette défloraison de l’horreur du monde, ce pourrissement de toutes choses, secret si bien celé aux âmes enfantines : tout ceci est voué à disparaître, les hommes, leurs bâtisses, leur société, leurs croyances, etc. Et l’écriture, comme inscription dans un temps long d’instants reconstitués peut conserver, plus longtemps que la seule mémoire des hommes, si fragile, l’essence de la vie, les sensations et les pensées.
Une troisième mort occupe l’extrême fin du récit, discrète, car presque indicible : le décès de la jeune épouse. La réserve dont fait preuve Arséniev à cet égard bouleverse plus que de larmoyants développements ; se mêle, comme dans Le Jardin des Finzi-Contini de Bassani, la joie d’avoir vécu et la douleur d’avoir perdu ; que le narrateur soit là, encore en vie, assis, écrivant des décennies plus tard, animant par la plume sa jeune épouse, alors que son corps à elle est en terre, décomposé, depuis si longtemps, suffit. Ramener à la vie, par le souvenir, la jeune femme, c’est se rappeler sa vie et sa disparition, dans une alternance de réconfort et de souffrance ; mémoire d’un bonheur réel quoique précocement anéanti et d’une douleur trop atroce pour être énoncée dans sa plénitude. Ce sont peut-être les plus belles phrases, les plus émouvantes, que celles par lesquelles Arséniev vacille entre la résurrection d’un amour (aussi imparfait et insatisfaisant fût-il) et la perspective inéluctable de son tombeau. Ces trois morts sont les trois blessures inguérissables, désignées et non soignées : la fin d’une société, la fin d’une famille, la fin d’un amour. Pour l’exilé trois fois mutilé, ce retour sur soi qu’est La Vie d’Arséniev offre, dans l’espace clos de l’œuvre, acte créatif opposé au temps, grand destructeur, le moyen de faire revivre ce qui ne vit plus.
Quand il raconte sa jeunesse, un écrivain peut être tenté de tracer le chemin de sa vocation, son effloraison, son épanouissement, au détriment du reste. Il y a de cela chez Bounine : un sentier littéraire particulier, suivi en dépit des avertissements des uns et des autres, la naissance d’un artiste, sa réussite, etc. Pourtant, le poète – car Bounine s’est d’abord voulu poète, donc œil, oreille, peau, âme – le poète ne peut être séparé du monde dans lequel il développe ses facultés. Le parcours de l’écrivain n’est pas celui de l’homme de lettres ; comptent plus ses émotions et ses visions que ses rencontres et ses réussites. Le paysage importe ; l’entourage importe ; les premières lectures importent ; la petite réussite sociale, quant à elle, compte peu – surtout chez un noble, qui n’avait pas à quêter une supériorité, héritée et non conquise. Arséniev n’est pas un personnage de Balzac, son ascension ne compte pas ; sa formation est d’abord sensible, morale, intellectuelle. Bounine peint une floraison des sens et de l’esprit. Les réflexions sur Lermontov, Pouchkine, Nekrassov, Tourguéniev, Tchernychevski, Bielinski et bien d’autres occupent une part du texte : très vite, le jeune homme a su quelle littérature défendre, à distance des modes engagées pour lesquelles il montre une souveraine ironie, une indépendance, marque d’un esprit fort. L’esthétique d’Arséniev correspond étroitement à celle de Bounine. Le Dit du Prince Igor le passionne quand Que faire ? l’ennuie ; Bounine se situe dans la grande tradition littéraire de son pays et refuse les engagements de l’heure, les satires faciles, les récits à thèse. Son style – quoi que le lecteur puisse éprouver de son lyrisme derrière les filtres d’une traduction – le démontre assez. Le comité Nobel, en lui attribuant sa récompense, évoqua le talent artistique avec lequel il perpétua, en prose, les formes traditionnelles de l’écriture russe. C’est à la fois vrai et un peu réducteur. Son classicisme lyrique se double d’une profonde capacité à animer un tableau, par ses détails (et le génie de la littérature, disait, entre autres, Nabokov, passe par le détail) : il émeut par de menus souvenirs, un cheveu, une odeur, des fragments mnésiques ; il touche par sa force de composition, qui mêle plusieurs passés en une seule scène, pour leur donner la profondeur manquant à l’instant brut. Cela signe l’auteur de première importance.
Si elle est située temporellement et littérairement, la Vie d’Arséniev l’est aussi spatialement. Ce livre est marqué par les paysages, l’immense étendue cultivée autour d’Orel, la fertile plaine du Don. L’adulte capture dans les rets de ses phrases l’enfant observant, fasciné, la nature ; un océan sans formes, un silence parfois absolu, un pays sans bornes. De telles impressions frappent de jeunes imaginations. Bounine n’avait pour tout point de fuite et tout horizon qu’une surface plane. Le vieux manoir, cerné par l’infini, fut pour lui une première école des sens. Le poète, par principe, met en formes ce qui n’en a pas, l’instant, la vie, l’image ; il délimite, il creuse, il coupe – pour mieux faire exister, par distinction, transposé en mots, ce qui importe du reste ; au ras d’une steppe sans fin, naît, chez une âme d’envergure, sensitive, puissante, un besoin de formes, de limites, de régulation ; l’écriture est une réaction face à l’informe du paysage – comme face à l’informe du temps, cet amas d’instants arithmétiquement identiques et pourtant absolument inégaux ; éprouver l’infini dans sa chair, l’accepter, l’enter sur sa sensibilité, conduit au mysticisme, ou à la poésie. Bounine n’est pas devenu un de ces ermites Vieux-Russes ; il a choisi la voie de l’art. Et dans l’espace fermé de ces pages, à distance de l’endroit, à distance de l’époque, il retrouve, par l’effort intense de son esprit, par la force de son expression, l’exacte mesure de l’infini, qu’il conjugue à la première exigence de l’art, la forme. La remémoration unifie diverses sensations, dont les correspondances n’existent que dans le temps vécu du poète. Des échos se répercutent dans la steppe ; les instants de tous les passés se mêlent ; et, par la bienfaisante forme, trouvent au-delà du présent les moyens d’une réverbération continue, car il suffit de lire et de relire pour éprouver à nouveau le sentiment évanoui.
Il est d’autant plus difficile d’évoquer cet aspect de l’œuvre qu’aucun commentaire n’épuisera la beauté du propos, son exact équilibre, sa perfection – que l’on devine, et à laquelle on croit, malgré le filtre toujours trop opaque de la (très belle) traduction. Tenter de comprendre et de disséquer par de rationnelles considérations les profondeurs émouvantes d’un texte est un exercice presque impossible ; les deux exercices sont trop opposés, la raison et le sentiment se font barrage ; La Vie d’Arséniev parce qu’elle m’a touché est, je m’en rends compte à force de peiner sur cette note, aux limites de ce que je peux évoquer. En le lisant, j’ai vécu ces instants où ce qui compte n’est ni l’originalité, ni la nouveauté d’un texte, ni ses idées, ni ses principes, ni son intrigue ; cet instant, si rare dans une vie de lecteur compulsif, c’est celui où il vous touche, exactement, parfaitement, là où vous êtes, comme vous êtes, tant votre âme que votre esprit. Je lis pour apprendre ; je lis pour éprouver ; tout livre enseigne quelque chose – même à ses propres dépens ; peu émeuvent, si peu qu’il faut peut-être ne pas creuser, ne pas chercher à desceller l’ouvrage, à déceler ses secrets ; les garder pour soi, et inviter autrui non à le comprendre, mais à le sentir et donc à le lire.