 André Suarès, l’Insurgé, Robert Parienté, 1999
André Suarès, l’Insurgé, Robert Parienté, 1999
Suarès est un écrivain secret, que le lecteur ne peut découvrir que sur la recommandation d’un autre lecteur. Il n’est pas de ces auteurs-talisman, qui prennent place dans les listes de name-dropping du commentaire littéraire contemporain. Gide, Valéry et Claudel, eux, n’ont pas besoin d’être redécouverts. Suarès toujours. Les uns sont pléiadisés, consacrés, étudiés. L’autre est sans cesse menacé par l’oubli. Suarès n’est connu que d’une fraction d’amateurs qui se satisfont amplement d’appartenir à une petite confrérie de gens de goût. Suarès exige de l’attention, du temps, de la sensibilité, il ne se survole pas en quelques minutes, il se savoure. Régulièrement, un de ses admirateurs essaie de remettre en pleine lumière l’œuvre immense du poète marseillais. Parienté, décédé en 2007, ancien directeur adjoint de L’Equipe, biographe de Michel Jazy, fut de ceux-ci. Pour un journaliste sportif, s’attaquer à André Suarès, normalien, poète, écrivain austère et ardu, étonne et suscite la méfiance instinctive du lecteur, lettré ou semi-lettré.
Suarès (1868-1948) ne fut pas l’homme des coteries littéraires, des revues à fort tirage et des picrocholines controverses du milieu des lettres. Sa plume, ardente, était au service de l’art et de l’intégrité. Suarès ne rendait pas hommage pour obtenir une récompense en retour. Il exultait, combattait, exaspérait. Une vie tourmentée comme la sienne, sans reconnaissance, marquée par la mort et la tragédie, aurait abattu moins solide que lui. Le poète maudit meurt jeune, paraît-il. Pas Suarès. A l’inverse de tous les malheureux qui brûlèrent leur talent en quelques années, qui partirent « trop tôt », à l’inverse de Verlaine ou de Rimbaud, de Kleist ou de Leopardi, Suarès vécut près d’un siècle. Entré à Normale avec Romain Rolland à 17 ans, il s’éveilla à la politique en pleine affaire Dreyfus et s’éteignit sous la IVe République. L’œuvre, gigantesque, s’oriente dans trois directions : l’art, la politique, la critique.
Artiste, Suarès l’était indubitablement : esprit vibrant à la moindre émotion esthétique, il fit de ses récits de voyage – dont Le voyage du Condottière, son chef d’œuvre – de magnifiques poèmes en prose, centrés sur les paysages, les lumières, les bâtiments, les villes. Parfois injuste, souvent sublime, Suarès évoquait le monde au tamis de la beauté. Ses relations, avec le sculpteur Bourdelle ou le peintre Rouault, le maintenaient en contact avec l’art moderne. Politique, Suarès ne le fut qu’aux grandes occasions, mais elle ne manquaient pas en ce temps tourmenté : Dreyfus, les guerres mondiales, l’hitlérisme … Prophète enragé, il déplora le premier l’inanité des Traités de 1919, avertit la société du péril fasciste alors que se jouait en France une comédie insouciante. Dans une société brisée par 14-18, lâche et veule, sa voix tonnait contre les concessions à Hitler, contre les ambitions de Mussolini, contre la pusillanimité de la France. Elle tonnait tellement qu’on la fit taire, trop dangereuse pour la paix que les gouvernements espéraient encore obtenir d’Hitler. Quand Benda exigeait de l’intellectuel le détachement, Suarès enfilait son armure, et descendait combattre. Une ligne de Suarès a d’ailleurs plus de sincérité et de poids que l’œuvre de l’infect Benda, pacifiste devant Hitler, stalinien devant le goulag. En 1940, Suarès, juif de naissance, agnostique de conviction, fuit en zone sud. Les sicaires de l’Allemagne le cherchèrent un temps – mais il avait changé d’identité. Outre les activités artistiques et politiques, Suarès investit la critique littéraire, comme de nombreux esprits de son temps. Il écrivit sur Pascal, Dostoïevski, Ibsen, Tolstoï ou Baudelaire, mettant son intelligence acérée au service de la compréhension globale de ces œuvres.
Parienté connaissait ses capacités : il renonce d’emblée à écrire sur l’œuvre de Suarès, se contente de citer quelques extraits. Toute biographie littéraire est écartelée entre le récit de vie et l’analyse de l’œuvre. Rares sont celles qui parviennent à équilibrer la compréhension et la chronologie. Parienté ne s’y essaie pas : il narre la vie de son sujet, et n’aborde pas ses livres. Dommage de se limiter à la partie peut-être la moins intéressante de l’existence d’un écrivain. Suarès vécut tragédie personnelle sur tragédie personnelle – sa mère meurt alors qu’il était enfant, son père disparaît après une atroce agonie, son frère est tué accidentellement à 25 ans, ses amis et protecteurs disparaissent les uns après les autres – accident de voiture, assassinat – la liste est longue. D’une existence passée dans l’ombre, sans guère de reconnaissance, il tira néanmoins suffisamment de matière pour produire une des œuvres les plus amples de la littérature française.
Altier, Suarès gâcha par son intransigeance nombre de relations – qualifier Gide, grand entremetteur des Lettres françaises, de Goethe des mouches et Paul Valéry de Descartes d’école primaire n’apporta rien à sa gloire. Son ardeur polémique brûla son vaisseau. Une vie pauvre et tragique l’endurcit : la difficulté d’accès de ses écrits pour le commun et son désir très ambivalent de reconnaissance contribuèrent à le laisser dans l’ombre de contemporains moins doués. Néanmoins, il composa de manière suffisamment brillante pour agréger à lui quelques admirateurs qui perpétuèrent son œuvre. Le voyage du Condottière demeure, malgré les évolutions du style et de la langue, l’un des plus beaux livres du siècle, injuste, polémique, redoutable, ardent, qui atteint par moments une pureté incandescente qui rachète et ennoblit.
Au final, Parienté livre une biographie satisfaisante, dans les limites du genre : il connaît les sources, les correspondances, et la vie de Suarès. L’aspect proprement littéraire est évacué, Parienté, à juste titre peut-être, ne s’aventure pas sur le terrain des écrits de Suarès. Il en cite quelques passages, mais ne rend pas réellement hommage à la profondeur, à l’intelligence et à l’incandescence de l’écrivain marseillais. Parienté a cependant eu raison de se battre pour sauver Suarès de l’oubli et, ainsi permettre les rééditions de ses œuvres. Grâce à lui, l’ardeur du maître continue de consumer chaque année quelques nouveaux lecteurs qui y découvrent, enchantés, la finesse, la profondeur et l’intelligence d’un des plus beaux écrivains du siècle. Si Parienté a eu un mérite, ce fut de contribuer, à hauteur de ses propres capacités, à la survie posthume du poète.
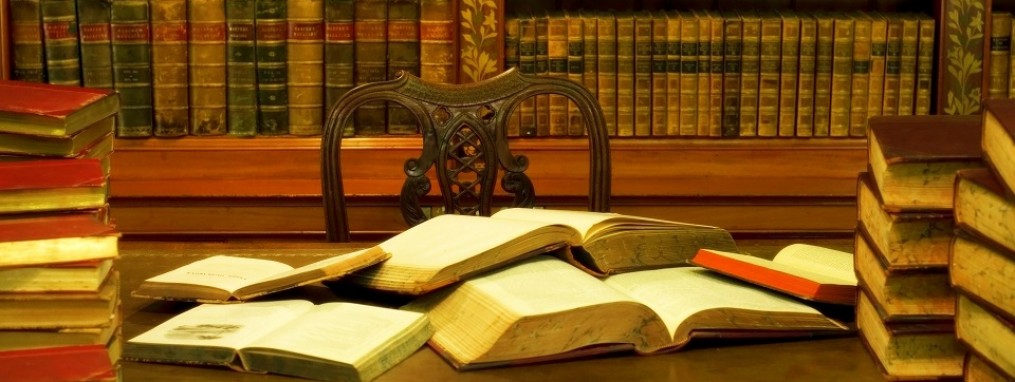
Si j’ai bien compris, Suarès s’est rendu assez détestable auprès de ses contemporains, et les rares à connaître son oeuvre aujourd’hui sont ceux qui ont fait l’effort et pris le temps de le découvrir et de l’apprécier…. Je ne suis pas étonnée que cet auteur t’intéresse 😉
Je ne dirais pas détestable, mais entier… Non je ne me sens pas concerné ! 😉
Pingback: Une année de lectures V : écrits paralittéraires « Brumes
Pingback: Demi-portrait d’une âme ardente : André Suarès, de Robert Parienté | Henosophia TOPOSOPHIA μαθεσις uni√ersalis τοποσοφια MATHESIS οντοποσοφια ενοσοφια