Des impératifs personnels et professionnels m’ont empêché de publier de nouvelles notes ces deux dernières semaines. Le mois d’avril pourrait être lui aussi un peu perturbé. Je vais cependant essayer de ne pas déroger trop souvent au rythme traditionnel de ce blog.
Comme ma note consacrée aux œuvres de Machiavel était définitivement trop longue, je l’ai décomposée en trois parties, d’importance égale. Je n’en publie que la première aujourd’hui. Les deux autres devraient suivre lundi et jeudi. Je n’avais pas prévu de la diviser mais je me suis dit qu’elle risquait de décourager à peu près tout le monde par sa longueur. Son découpage peut apparaître un peu artificiel à la lecture, malgré mes efforts pour « aiguiser les angles » entre chacune des trois sections ; son plan n’a pas la rigueur des plus belles dissertations de Sciences Po, mais il a tout de même sa cohérence.
Je sais bien que des centaines de personnes ont écrit sur Machiavel depuis cinq siècles ; néanmoins, je crois nécessaire, à un moment ou à un autre, pour un lecteur d’aujourd’hui, de se réapproprier les classiques, par une lecture personnelle, un peu subjective, hors des sentiers de l’enseignement et de la philosophie.
Œuvres Complètes, Nicolas Machiavel, Gallimard, « Bibliothèque de la Pléiade », 1952
Un dicton bien connu veut que l’histoire soit écrite par les vainqueurs. Elle l’est aussi par les vaincus. Prenez Retz, prenez Saint-Simon, prenez Nicolas Machiavel. Ces hommes ont été battus, chassés du pouvoir, exilés sur leurs terres. Ils perdirent la maîtrise de leur présent immédiat ; ils se ressaisirent en contrepartie du passé – par l’écriture – et de l’avenir – par la postérité. Si les Médicis n’avaient pas relevé de ses charges et exilé le secrétaire de chancellerie et diplomate Machiavel, ce dernier n’eût presque rien écrit de son œuvre. Quelle ironie que de penser à ce coup du sort littéraire : si la Fortune politique avait été plus généreuse avec Machiavel, il serait resté à son poste, conduisant, jusqu’à la fin, certaines obscures affaires d’État de la république florentine. Nul, sinon quelques historiens de la Renaissance, ne connaîtrait aujourd’hui son nom. Or, cette fortune, qui est au cœur de la pensée machiavélienne, a été plus généreuse que le diplomate florentin ne le pensait dans ses vieux jours. Aucune ingratitude de sa part : plutôt que la gloire éphémère d’avoir servi jusqu’au bout un petit État, elle lui a offert une longue et tumultueuse postérité. Machiavel est devenu un classique ; ses écrits ont suscité autant d’admiration que de rejet, et cinq siècles plus tard, ses œuvres, presque toutes publiées à titre posthume, font partie du patrimoine historique, philosophique et littéraire de l’occident. Je noterai, rapidement, que le volume de la Pléiade dans lequel j’ai lu ces œuvres, assez ancien, est plutôt décevant : très peu de notices, des notes de qualité variable, et, surtout, des traductions dépassées – que rachète en partie leur côté rocailleux, d’époque. La connaissance de Machiavel est bien meilleure aujourd’hui que dans les années 50. Elle justifierait largement une refonte du volume, où manque, en outre, une grande partie de la correspondance (épuisée dans son édition NRF). Il paraît que l’édition « Bouquins » (1999) est meilleure. J’ai néanmoins lu ce volume de la Pléiade en intégralité ; je vous rassure, je ne vous infligerai pas une note par œuvre de l’écrivain florentin. J’ai préféré écrire une forte note, que je divise en trois : la première pose quelques jalons sur l’écrivain, la deuxième s’intéresse à la dualité contradictoire de l’œuvre, la troisième se consacre à l’exploration de quelques-uns de ses aspects philosophiques et historiques. Il serait présomptueux de prétendre évoquer ici en profondeur un penseur qu’ont étudié des auteurs comme Spinoza, Rousseau, Arendt, Strauss, Lefort ou Althusser. Je renvoie les lecteurs à ces gloses ; ou, mieux, aux textes de Machiavel eux-mêmes. Cette note ne prétend ni à la philosophie, ni à la littérature ; considérons qu’elle constitue un libre parcours dans l’œuvre du Florentin. On me pardonnera, j’espère, de me confronter à ce classique sans filtre, ni filet. Il faut toujours revenir à l’essence : le texte, et tenter de l’affronter seul à seul – pour se forger un avis propre, à distance des légendes, blanches ou noires.
En privant Machiavel de ses charges publiques en 1513, les Médicis lui ont donc donné le temps d’écrire l’histoire, mieux, de penser l’histoire. Ils perdirent un diplomate d’exception, l’Italie y gagna un de ses plus grands écrivains, digne, comme Dante, Boccace, Pétrarque, Vico, Leopardi, Manzoni ou Foscolo du panthéon des lettres italiennes. Souvent, Machiavel est lu comme un philosophe, par des philosophes s’intéressant à la philosophie ; on minore l’écrivain au profit du penseur. Rappelons qu’il fut aussi un styliste, un authentique écrivain, capables des fulgurances les plus frappantes et les mieux tournées. Et bien que, parfois, dans le cours de ses ouvrages, tel ou tel récit des dissensions florentines ennuie un peu, des formules saisissantes réveillent à temps l’intérêt du lecteur. C’est dans le raccourci inattendu, l’aphorisme soudain qu’il brille le plus visiblement ; c’est dans les profondeurs de la composition, dans la subtilité du tissage des mots qu’il couronne ses efforts d’écrivain. Le labeur de Machiavel est trop souvent ramené à son ouvrage phare. Qu’on songe pourtant un instant à l’ampleur d’une œuvre composée en dix ans à peine : Le Prince est certes un court traité, mais les Discours sur la première Décade de Tite-Live font près de quatre cents pages « Pléiade », les dialogues de L’Art de la guerre, une centaine et les Histoires florentines cinq cents. Sans compter deux pièces, des séries de poèmes inachevés, une Vie et une correspondance nourrie. Comme beaucoup, Machiavel a écrit parce qu’il s’ennuyait – et il ne s’en cache aucunement dans ses lettres familières. L’exil et l’oisiveté aiguisent la plume. La lecture oriente l’auteur, comme il convient à cette époque, vers l’imitation des grands auteurs, historiens, dramaturges et poètes. Si l’intérêt de la poésie machiavélienne tient principalement, il faut le reconnaître, à l’éclairage qu’elle apporte aux grands textes historico-philosophiques, le théâtre tient seul et la nouvelle Belphégor divertit efficacement. Quoi qu’il en soit, malgré les Capitoli (Quatre poèmes : Occasion, Fortune, Ambition et Ingratitude – thèmes machiavéliens s’il en est), compositions que j’ai trouvé plaisantes, c’est sa prose qui fait l’intérêt de l’œuvre de Machiavel. Pour écrire ses principaux livres, il puisa à deux sources principales : la longue tradition historique antique, chère aux humanistes, et son expérience de quinze années agitées au service de la République de Florence. Ce sont deux pôles opposés : l’exemplarité classique se heurte de front à la dégradation moderne ; l’antique vertu au vice présent ; le moralisme d’hier à l’amoralité d’aujourd’hui. Cette contradiction n’est pas la seule à sourdre dans les grands livres du Florentin. Sous son apparence de bâtisse harmonieuse et solide, l’œuvre de Machiavel témoigne en effet, je l’exposerai plus avant dans la deuxième note (Joint d’une inconcevable jointure), d’une tension, d’un déchirement.
La vie de Machiavel est inégalement connue. On sait qu’il est issu d’un milieu lettré et modérément bourgeois, mais sa jeunesse reste obscure. Il a reçu une éducation honorable de serviteur de l’État ou des compagnies financières – il a des connaissances en comptabilité. L’histoire perd sa trace quelques années, et il ne s’impose dans les affaires publiques extérieures florentines qu’à la fin du règne spirituel du millénariste Frère Jérôme Savonarole, brûlé en 1498. Dès lors, pendant quinze ans, il participe à de nombreuses expéditions diplomatiques pour le compte du régime républicain, auprès de César Borgia, évidemment, mais aussi de l’Empereur Maximilien, de Louis XII ou de Jules II. Il a la confiance du chef de l’État, le gonfalonier Soderini, personnage modéré et consensuel. Le retour brutal des Médicis met néanmoins un terme à sa carrière, qui ne reprendra, timidement, qu’à la toute fin de sa vie (jusqu’à une deuxième révolution). Relégué dans sa « pouillerie », dans le contado, à partir de 1513 et, presque sans interruption, jusqu’à sa mort en 1527, Machiavel passe, je l’ai dit, cette longue décennie à écrire : une ample correspondance, des pièces de théâtre, des poèmes, des œuvres historiques, des traités, et, bien évidemment, ce pour quoi il est resté dans la postérité Le Prince. Il ne faut pas se limiter à ce seul traité, quoique sa centralité ne puisse être remise en cause. Machiavel est tout autant lui-même dans les profonds Discours sur la première décade de Tite-Live, dans la drolatique Mandragore, dans les éloquents Capitoli, dans la « plutarquienne » Vie de Castruccio Castracani de Lucques, ou dans les monumentales Histoires florentines. C’est un auteur cohérent en apparence et dont la structuration philosophique se retrouve d’œuvre en œuvre. On y retrouve, dans une pensée historique fondée sur le principe de la contingence, sa fascination pour l’opportunité à saisir, son éloge de la virtù de l’homme d’action, sa haine du mercenariat et des factions, un certain manque de spiritualité, une lucidité aiguisée et ironique, un iconoclasme qui touche au sacrilège, et, bien sûr, une conception étroitement pessimiste de la nature humaine. Occasion, Fortune, Ambition, Ingratitude. Les Capitoli donnent déjà les grandes obsessions de l’œuvre. La pluralité des genres qu’il pratiqua ne doit pas tromper : son système de pensée est fermement établi ; son écriture, toujours reconnaissable, se distingue par sa clarté. C’est un prosateur élégant et convainquant, rationnel, parfois truculent par ses florentinismes, souvent drôle par son ironie subtile, éloquent sans jamais être rhéteur. Son italien, transposé dans d’autres langues latines, garde un reflet de sa finesse originelle. Machiavel est prudent pour formuler ses imprudences : son style discret et circonspect enrobe d’autant mieux ses transgressions qu’il évite le lyrisme ou l’emphase. Et pourtant, malgré sa cohérence intellectuelle, sa fermeté théorique et littéraire, son apparente simplicité, stylistique et philosophique, son œuvre est un prisme d’une immense complexité, un jalon décisif dans l’histoire des idées – la première rupture vers la modernité.
Machiavel donna à certains de ses textes l’apparence rassurante d’un enseignement, destiné explicitement à ceux qui gouvernent (Le Prince), à ceux qui se battent (L’Art de la guerre) et à ceux qui voudraient commander (Discours). Si les dirigeants de Florence ne l’écoutaient plus, Machiavel avait quelques disciples qu’il faisait bénéficier de son expérience. Ils l’incitèrent à approfondir ses efforts. Il était servi par une remarquable agilité d’esprit et une grande facilité d’écriture. Le Florentin ne se contentait pas de mêler théorie classique et pratique pragmatique dans des écrits aussi révolutionnaires que sacrilèges ; il était aussi un prosateur de premier ordre, un des pères de la langue italienne. L’écriture machiavélienne étonne, par une contradiction apparente : tout est énoncé avec une élégance froide et lapidaire – qui désigne chez lui le lecteur acharné des meilleurs auteurs latins, Tite-Live et Cicéron – et pourtant, rien n’est dit si explicitement qu’il n’y paraît. Machiavel est habile au sous-entendu et au demi-mot, et un lecteur trop hâtif ou inattentif peut passer à côté de certains arguments ou, plus sûrement, tomber dans un des pièges qu’il tend régulièrement. Ses portraits de Cosme l’Ancien et de Laurent le Magnifique sont des modèles du genre : il faut creuser dans le texte pour avoir une chance, par déduction, de savoir ce que Machiavel pensait vraiment d’eux. Certains silences en disent plus que mille condamnations. D’ailleurs, n’annonce-t-il pas dans un des chapitres du Prince, comme l’a pointé astucieusement Strauss, qu’en matière tactique les erreurs les plus énormes ne peuvent en être et qu’elles doivent toujours être comprises comme des pièges ? Ce constat s’applique à ses livres. La vivacité de sa prose dissimule l’extrême minutie avec laquelle a été tissée la toile du texte, entre définitions contradictoires, échos discrets, rappels, termes équivoques et propos en apparence paradoxaux. Ses lecteurs – et je parle des meilleurs, des plus philosophes d’entre eux, de Rousseau, de Spinoza, de Lefort, de Strauss, de Revel – ses lecteurs donc, ne sont pas toujours d’accord les uns avec les autres. Question de degré de lecture. Question de sensibilité. L’un verra de l’ironie, l’autre pas ; l’un identifiera une contradiction, l’autre passera à côté. Lire Machiavel vous réapprend à lire, à être attentif à l’explicite, à l’équivoque, à l’ambigu. On l’a longtemps présenté comme un cynique d’une explicite (et bête) brutalité ; il faudrait plutôt lire ses textes, désormais, comme un mélange d’ironie et de blasphèmes, de franchise et de subtilité, d’obscurités voulues et de clartés équivoques. Travestis en vérités franches par un conseiller retors et avisé, s’énoncent dans la profondeur du texte autant de demi-vérités que de demi-mensonges. Et cela, je crois, désigne bien le premier prosateur d’Italie.
Dans les deux notes à venir, j’explorerai les tensions apparentes de l’œuvre et, modestement, ses fondements historico-philosophiques.
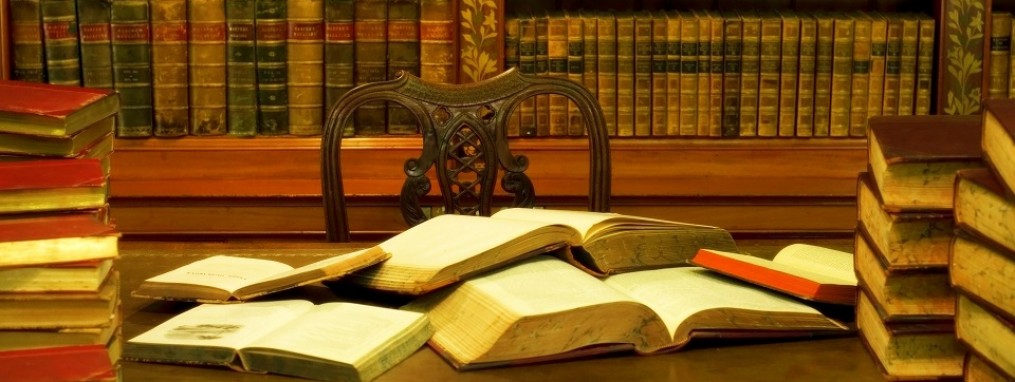

Bonsoir Brumes,
Je vous adore. Continuez!
odp