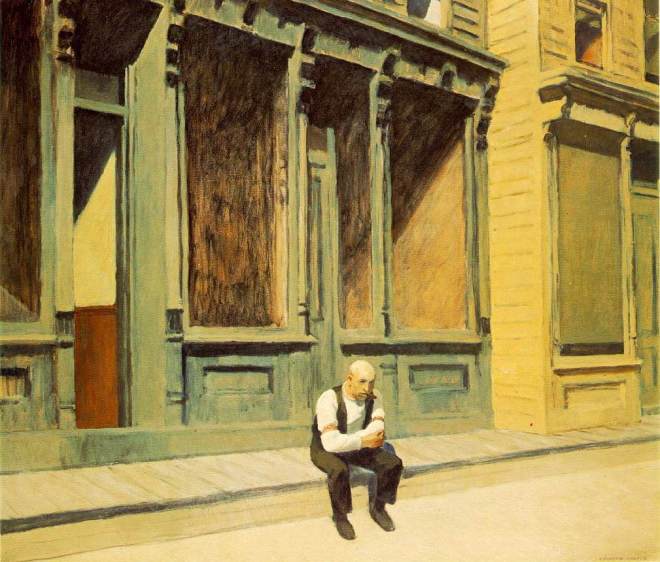Miss Lonelyhearts, Nathanaël West, Éditions Sillages, 2011 (trad. Marie Picard) (première éd. 1933)
Par Les Somnambules, épais roman paru en 1931, Hermann Broch souhaitait développer, sous une forme littéraire, une théorie de la « dégradation des valeurs » de la société allemande entre 1870 et 1918. Il observait, par ce texte choral et passablement glaçant, la lente déréliction d’hommes de bien, partis d’un sentimentalisme romantique hypocrite pour arriver, en passant par un moralisme subjectif, anarchique et inefficace, à une « objectivité » (ou Sachlichkeit) amorale. Ses personnages reflétaient cette évolution. Le lieutenant Pasenow, héros de la première partie, était déchiré entre une aspiration sentimentale idéaliste et des désirs charnels culpabilisants ; le journaliste Esch, héros de la deuxième partie, était partagé entre sa dénonciation morale des fautes de la société et son désir de réussite et d’ascension sociale. Bien d’autres personnages incarnaient dans le roman ce que Broch appelait la dégradation des valeurs, c’est-à-dire la progressive calcification des valeurs portées par les individus et l’inadaptation de ceux-ci aux nouvelles exigences, amorales et techniques, de la société. Seul le prosaïque Huguenau s’en tirait, lui dont l’objectivisme froid et inhumain préfigurait déjà, visionnaire, les Adolf Eichmann de l’ère nouvelle. Selon Broch, les individus se référaient, dans leur vie sociale, à une série de valeurs dont la plupart étaient dévoyées ou périmées ; de là naissaient leurs souffrances et leur sentiment d’inadéquation. C’est à ces Somnambules de Broch, lu l’an dernier, que j’ai immédiatement pensé en lisant le court roman de Nathanaël West, écrit à peu près à la même époque. Il est toujours troublant d’observer, à travers deux cultures éloignées, le même constat. La taille des deux ouvrages n’est certes pas comparable : Broch écrit un monstre de 700 pages, d’une densité philosophique et poétique qui annonce déjà son chef-d’œuvre, La mort de Virgile ; West est l’auteur d’un roman (ou d’une nouvelle ?) d’une centaine de pages, très aérées, le seul véritable succès d’une carrière malheureuse et accidentellement écourtée. Pourtant, malgré ces différences, West, comme son contemporain, observe la dégradation des valeurs collectives américaines, par le biais d’un personnage inadapté dont la crise révèle celle de toute une société.
Miss Lonelyhearts, à l’examen de son résumé, aurait pu être un roman satirique grinçant à la Evelyn Waugh, une de ces charges réjouissantes contre la presse sentimentale et la psychologie de comptoir qui la nourrit. En amateur des grands humoristes anglo-saxons, je m’attendais à un texte amusant et fulgurant, digne de Saki ou de Chesterton. Comme j’ai tracé ci-dessus un parallèle avec Hermann Broch, vous aurez compris que j’ai été vite détrompé. Personne ne qualifierait, en effet, l’immense écrivain autrichien d’humoriste. Le livre de West n’a, lui non plus, rien de drôle. Si l’on rit, à l’occasion, ce rire est noir, si noir qu’il tend plus à la grimace qu’au sourire. Un jeune journaliste est recruté par un journal pour écrire des chroniques « psychologiques », une sorte de courrier du cœur pour lequel il prend le pseudonyme de « Miss Lonelyhearts ». Réduit à cette fonction qui va l’obséder, le personnage n’est jamais présenté sous son vrai nom. Le roman se déroule dans les années 30, l’idée de s’adresser directement au lectorat féminin, d’entrer en dialogue avec lui, de proposer une oreille compatissante et des conseils, est encore assez nouvelle. La mission du journaliste est de répondre aux questions des lectrices, esseulées, inquiètes ou déprimées, de manière à attirer auprès du journal tout un lectorat d’urbaines désorientées. Miss Lonelyhearts doit-il prendre son travail au sérieux et livrer de véritables conseils ? Ou lui suffira-t-il d’inventer quelques réponses fictives, sous forme de vagues leçons morales ? Au départ, le journaliste est tenté de prendre son métier pour une vaste blague, comme le lui propose son entourage. La narration le surprend en train de rédiger de très vagues conseils (du type « demain, il fera jour », « après la pluie, le beau temps »), hésitant entre l’optimisme le plus plat et le moralisme le plus éventé. Face à ces articles médiocres, émerge néanmoins, sincère, une demande d’écoute et d’assistance. Les lettres de lectrices, citées in extenso, occupent une dizaine de pages du texte. L’écrivain s’y livre à un exercice de style réussi : si la langue est malmenée, la cohérence parfois absente et le propos obscur, il émane de ces lettres une grande souffrance. La langue est brisée, comme les corps, comme les âmes. Ces lettres sont une lame effilée, qui blesse Miss Lonelyhearts un peu plus chaque jour.
Le journaliste se trouve submergé par une souffrance qu’il n’imaginait même pas. Devant lui, s’étalent non des lettres maladroites, mais des appels au secours sincères. La vague blague devient un exercice sérieux. Or, que peut ce journaliste, ce « Miss Lonelyhearts » dont tout le personnage est marqué par la fausseté et l’hypocrisie ? Rien et il le sait. Comme le dit Schopenhauer, je crois, la pleine et entière conscience de la souffrance du monde nous rend toute vie impossible. À force de se confronter à des situations auxquelles il ne peut apporter aucun remède, le jeune journaliste commence à entrer lui-même en crise. Comment écrire ces vagues articles, mi-parodiques, mi-sérieux, sur la résolution des problèmes personnels lorsqu’en face émerge une authentique souffrance ? Que sont ses articles, sinon d’inutiles crachats au visage d’êtres vaincus par la vie ? Comment faire face ? Comment leur permettre de faire face ? Miss Lonelyhearts est impuissant, le sait, et ne parvient pas à l’accepter. Chaque fois qu’il essaie d’achever un de ses articles, le récit le montre hésitant, raturant, reprenant, avant d’abandonner. Malgré un environnement professionnel cynique, le journaliste reste un idéaliste perdu, de plus en plus tenté, à mesure qu’avance le roman, par deux solutions opposées : la fuite ou le sacrifice. Il ne peut se décider pour la troisième solution, celle qui consisterait à affronter le réel, et à tenter de survivre en milieu hostile. Il ne peut non plus adopter une indifférence sarcastique, dont le rédacteur en chef se fait le héraut. Shrike, c’est son nom, incarne dans le roman le parfait cynique, moqueur, grinçant, odieux. L’onomastique livre une clé du personnage. Que signifie « shrike » en anglais ? la pie-grièche. Cet oiseau, un petit passereau des campagnes, est connu pour une caractéristique assez sinistre : il empale ses victimes (insectes, reptiles, petits campagnols) sur une épine ou une branche pointue, pour se constituer un garde-manger. Son nom d’espèce latin, lanius, fait référence au croc de boucher, au bourreau ou au scarificateur. S’il connaît ces quelques précisions, le lecteur devinera quel rôle joue Shrike dans la narration.
À un passage clé de l’œuvre, alors que le journaliste hésite à fuir ce métier qui le mine, Shrike lui dresse un tableau aigre et déprimant de ses possibilités. Pour un personnage médiocre comme lui, avilir l’espérance des autres, insuffler un doute fondamental à son propos, est le seul moyen d’exister. Shrike est de ces âmes basses qui ne connaissent qu’un registre : décourager, par leurs sarcasmes, l’idéalisme des autres. Il salit successivement, dans des paragraphes non exempts, tout de même, d’une méchante drôlerie, la vie campagnarde, l’amour, la vie sous les tropiques, le plaisir, la drogue et l’art (qu’importe que tu sois pauvre et laid, tu « as les pièces de Shakespeare en un volume »). Il n’y a nulle part d’échappatoire pour le jeune journaliste : dans tous les cas, il gâche sa vie et doit se préparer à des désillusions. Le salut personnel est un pari perdu d’avance. Telle une pie-grièche déchiquetant un petit insecte, Shrike démantèle les espoirs putatifs de Miss Lonelyhearts, produits dévoyés d’un idéalisme de comptoir ; il cherche, constamment, à l’avilir. Il faut comprendre que dans une société qui fait commerce, via des magazines, de la souffrance humaine, l’idéalisme, celui du jeune journaliste, n’est pas souhaitable. Il doit y renoncer rapidement : la presse n’est pas là pour aider ceux qui la lisent, mais pour leur faire croire que quelqu’un, quelque part, daigne les écouter, leur accorde une importance qu’ils n’ont pas. Miss Lonelyhearts ne peut pas apaiser les souffrances sans fin de l’espèce humaine ; ce serait là une tâche messianique, de gourou ou, à tout le moins, de prêtre. Le jeune journaliste, moqué par Shrike, rêve de sacrifice christique. Ne serait-ce pas le moyen de donner un sens, une direction à toute cette souffrance accumulée ? La tension accumulée par les lettres reçues au journal pèse dans toutes les relations du journaliste. La souffrance le paralyse jusqu’à le pousser à chercher le salut, et, partant, le sacrifice. Cette voie, facilitée par la mentalité collective américaine de l’époque, son rapport à la Bible, sa bigoterie, est-elle véritablement plus valable que les autres ?
Dans Miss Lonelyhearts, comme dans un roman de Faulkner, les idiots du sud en moins, tout est sale : le désir sexuel, les sentiments, les relations entre les êtres,… Les personnages s’enivrent lamentablement – comme toute la société américaine sous la Prohibition semble l’avoir fait – leurs espoirs sont médiocres et leurs sentiments, même sincères, recouverts d’une épaisse couche de cynisme glauque. Même les songes expriment symboliquement cette noirceur, comme ce rêve de sacrifice, éthylique et forcément raté, du début du livre. Un désir de brutalité, de sadisme méchant, sourd. Le désir dégénère en violence. À un moment, le journaliste, avec quelques verres dans le nez, s’attaque à un pauvre vieux. Il n’y a pas là de contradiction majeure avec son idéalisme : à force d’être confronté à la faiblesse humaine, de « devoir remettre à l’ouvrage son cœur compréhensif » (p.59), face à la farce sinistre du courrier des âmes perdues, un désir trouble de vengeance naît en lui. Inapte à faire le bien, Miss Lonelyhearts s’abandonne parfois au mal ; sont marqués par une forme de sadisme psychologique ses rapports avec Betty, la seule jeune femme qui semble pouvoir lui apporter un certain équilibre et l’apaiser. La pitié et le sadisme forment ici un couple permanent. On s’aide pour mieux se brutaliser. Ainsi (p.48), Miss Lonelyhearts se rappelle avoir ressenti de la compassion pour une grenouille écrasée… avant de s’acharner à l’achever. Il voudrait ainsi « tuer la douleur » (p.89), mais n’y parvient pas. Quand Betty offre sa compassion et son amour virginal, il lui vient l’envie de l’avilir ou de la quitter : là au moins s’expriment des sentiments vrais. Partout rôde l’insincérité, le dégoût de soi et le goût du toc, du faux, de la convention ; le corps est sale, souvent vu comme un objet, rattaché à sa fonction animale par diverses analogies et métaphores ; seule les deux pôles opposés de la charité et de la brutalité semblent authentiques. Quelle phrase conclut le moment où Betty et Miss Lonelyhearts tombent enfin dans les bras l’un de l’autre ? « Quand ils se laissèrent tomber, il sentit une odeur de sueur, de savon et d’herbe écrasée » Le prosaïsme de la narration est ici parfaitement houellebecquien. La réalité est disséquée, et curée de tout sentimentalisme. Ne nous trompons pas, comme Houellebecq, avec qui il partage une appréhension sombre et déplaisante de la société, West est un idéaliste déçu. La fausseté des rapports humains, la discontinuité de l’existence, composée, comme le roman, de petits morceaux disparates et décevants, ainsi que la tristesse du désir sexuel le désolent. Quant à la résolution de cette situation, il est peu dire que West n’en propose pas. L’expérience religieuse, vécue au terme du roman, n’est qu’une sinistre parodie, entrelacée de formules bibliques répétitives et satiriques, où le délire christique n’aboutit qu’au néant.
Miss Lonelyhearts apparaît de prime abord comme une charge très sombre contre la presse populaire, que West connaissait bien. Dans un second temps, à y réfléchir, le lecteur observe surtout l’avilissement de tout idéalisme dans une société pragmatique, qui a même fait de la souffrance et de la misère humaine une forme de fonds de commerce. La chute des valeurs, remplacées par un prosaïsme amoral, ne laisse plus guère de voies d’expression aux individus idéalistes (les individus cyniques et les pragmatiques ne sont pas touchés). Toutes les issues conventionnelles sont des mirages mal étayés, des simulacres impossibles à mettre en pratique, des trompe-l’œil. Ne restent que deux voies de sorties : la fuite et la névrose, qui toutes deux débouchent sur une forme de nihilisme. Miss Lonelyhearts ne se vante-t-il pas d’avoir « le syndrome du Christ » ? N’est-il pas l’incarnation de ce désir de fuite, transmué en névrose ? En un court roman, noire satire de la déréliction de l’idéalisme, Nathanaël West diagnostique un mal social que nous n’avons toujours pas soigné : le décalage entre la hauteur des aspirations morales que nous sommes supposés porter et la bassesse vulgaire de nos possibilités et de nos réalisations pratiques.